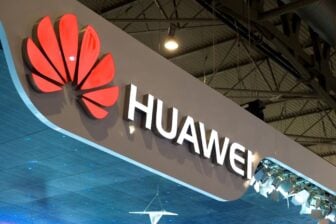À compter du 15 octobre prochain, le géant américain arrêtera de mettre gratuitement à jour son système d’exploitation Windows 10 : une fin qui entraînera la mise aux rebus de « 400 millions d’ordinateurs dans le monde », estiment Halte à l’Obsolescence programmée (HOP), l’UFC Que Choisir, Emmaüs Connect, et d’autres associations et entreprises. Ces dernières ont lancé une pétition lundi 15 septembre, pour tenter de faire pression sur le géant américain et dénoncer sur ce qui pourrait devenir « le plus grand scandale environnemental du 21ᵉ siècle », selon HOP. La vingtaine d’organisations demande « le maintien des mises à jour non payantes et sans contrepartie de Windows 10 jusqu’en 2030 ».
Dans moins d’un mois, Windows 10 ne sera plus mis à jour gratuitement. Microsoft incite ses utilisateurs à installer Windows 11, ce qui nécessite d’avoir un PC « compatible », comprenez, assez puissant. Pour beaucoup, cela signifie qu’il faudra acheter un nouvel appareil, à moins de ne pas mettre à jour son système d’exploitation. L’ordinateur continuerait alors de fonctionner, mais il serait plus vulnérable aux cyberattaques et aux vols de données personnelles.
Le géant américain a-t-il le droit d’agir ainsi ? La loi ne permet-elle pas aux consommateurs d’obtenir une plus longue mise à jour ? Comme toujours, « la règlementation est en retard sur le marché » rappelle en amont Lise Breteau, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies et l’environnement, avec laquelle nous nous sommes entretenus.
Aucune loi n’empêcherait les problèmes de type Windows 10
Commençons par les textes : le droit des mises à jour est régi en partie par un règlement européen chapeau (déjà en vigueur) d’où découlent des règlements par secteur, qui traitent d’éco-conception, nous explique-t-elle. Celui pour les smartphones s’applique déjà. Il impose depuis juin dernier un minimum obligatoire de cinq ans de mises à jour « à compter de la date de mise sur le marché ». L’indice REPAIR (de réparabilité) prévoit lui jusqu’à huit ans de mises à jour : « plus la durée sera longue, et plus les fabricants auront des points, même si ce n’est pas un élément décisif », nous précise Maître Breteau.
L’autre règlement sectoriel, pour les ordinateurs, n’a pas encore été publié. Résultat, le fabricant est pour l’instant seulement tenu d’informer ses clients de la durée de la mise à jour du système d’exploitation, lors de son achat, depuis la loi française Agec et un décret d’application de 2022.
À lire aussi : Mise à jour des systèmes d’exploitation, à quoi avons-nous droit lorsqu’on achète un ordinateur ou un smartphone ?
Donc « même si ces éléments constituent de belles avancées pour le consommateur, par rapport à la situation antérieure, ces textes-là n’empêchent pas des problèmes de type Windows 10, dans lequel on a des mises à jour qui ont duré plus longtemps que ces cinq ans. Et pourtant, on a un vrai problème d’obsolescence prématurée de centaines de millions d’ordinateurs », poursuit l’avocate.
Les entreprises ne peuvent pas se passer de mises à jour de Windows 10
Car pour les entreprises, ne pas mettre à jour leurs flottes d’ordinateurs n’est pas envisageable. « Les sociétés ne peuvent pas prendre le risque de ne pas avoir fait les ajouts de sécurité parce qu’elles ont, elles-mêmes, des obligations de cybersécurité, avec des sanctions à la clé », souligne Maître Breteau. Dit autrement, les sociétés ont l’obligation de se protéger, et de protéger les données de leurs clients, sous peine de voir leurs responsabilités engagées. Certaines devront donc aller jusqu’à changer leurs équipements, parce que leurs ordinateurs ne « supporteraient » pas le système d’exploitation Windows 11, trop gourmand en performance ou en mémoire pour le PC en question, résume Lise Breteau.
Selon HOP, l’UFC Que Choisir, et les 20 autres organisations, le coût pour l’environnement serait abyssal. « 400 millions d’ordinateurs remplacés, cela représente plus de 70 millions de tonnes de gaz à effet de serre, et l’équivalent du poids de près de 32 000 tours Eiffel de matières premières extraites », écrivent-elles.
Pour éviter ce scénario, il existe deux autres options : installer un système d’exploitation autre comme Linux – nous vous invitons à suivre nos tutos sur le sujet (voir l’encadré ci-dessous) – ou payer 26 euros environ pour obtenir les mises à jour de sécurité de votre PC jusqu’au 13 octobre 2026. Cette dernière solution est décrite comme « une taxe Windows » par les organisatrices de la pétition. À tort, ou à raison ?
Reprenons depuis le début. Microsoft a lancé Windows 10 en juillet 2015. En 2023, le géant américain a commencé à prévenir qu’il cesserait ses mises à jour deux ans plus tard, et qu’il faudra que votre PC dispose de certaines configurations techniques pour installer Windows 11 (avoir au moins 4 Go de RAM, disposer d’un processeur Intel ou AMD pris en charge, et surtout avoir une machine dotée d’une puce TPM 2.0).
En tout, la firme américaine aura mis à jour gratuitement ce système d’exploitation pendant 10 ans et trois mois. Cette durée va bien au-delà des cinq ans prévus pour les smartphones, et correspond aux dix ans préconisés en 2023 par l’Arcep, le gendarme des télécoms.
Mais elle reste toujours bien en deçà d’un minimum acceptable pour les associations de défense des consommateurs. Certaines organisations « poussent pour que l’on ait des durées vraiment extrêmement longues, du type 15 ou 20 ans. Compte tenu de la qualité de certains matériels, cela a du sens d’avoir des durées très longues de mises à jour sur des matériels qui restent fonctionnels pendant très longtemps », développe Lise Breteau.
Les politiques frileux à imposer 15 ou 20 ans de mises à jour obligatoires aux fabricants
Hop, l’UFC Que Choisir et la vingtaine d’autres organisations préconisent d’ailleurs de mettre en place une loi qui obligerait Microsoft et d’autres à un minimum de 15 ans de mises à jour de sécurité. Ce seuil reste pour l’instant loin des visées des politiques. « Les législateurs sont quand même extrêmement frileux à faire de tels sauts, à passer de mises à jour de 5 ans à des mises à jour de 15 ou 20 ans », explique l’avocate spécialisée.
D’autant qu’on pourrait, d’un côté, « se dire que 10 ans, c’est une durée assez longue, dans notre monde à nous. Mais le problème est que Microsoft est une entreprise en position de quasi-monopole. Ils équipent absolument tout le monde, toutes les boîtes, les ministères, les particuliers. La moindre de leur décision est extrêmement structurante pour le marché. Donc malheureusement, quand ils mettent en obsolescence prématurée des centaines de millions d’objets, c’est un vrai problème, très clairement. La difficulté dans ces sujets qui sont très émergents sur le numérique et l’environnement, c’est que la réglementation court complètement après le marché et essaye d’attraper les mauvais élèves, mais aussi ceux qui sont considérés comme bons élèves », poursuit Lise Breteau.
L’autre problème est qu’aujourd’hui, « les législateurs n’ont toujours pas osé imposer aux industriels comme les fournisseurs de systèmes d’exploitations de vraiment séparer les différents types de mises à jour ». Aujourd’hui, ces dernières arrivent par paquet. « On ne peut pas choisir ce qu’on veut rajouter ou pas. Et typiquement sur un smartphone, il va vous faire une mise à jour de sécurité, et il va vous rajouter des nouveaux smileys », ce qui n’est pas forcément indispensable.
Il s’agit là d’un vrai « blocage avec des industriels qui vont vous dire que c’est impossible de séparer les différents types de mise à jour. Ce qui est faux puisque historiquement sur le marché (…) les prestataires informatiques séparent les mises à jour parce qu’il y en a certaines facturées ou d’autres gratuites », rappelle-t-elle. Pourtant, « cela constituerait un vrai levier pour limiter l’obsolescence prématurée des équipements et pour allonger la durée de vie des équipements », plaide l’avocate.
Et le délit d’obsolescence programmée ?
En attendant, le délit d’obsolescence programmée, inséré dans notre droit depuis 2015, ne pourrait-il pas être utilisé pour contraindre Microsoft à proposer une mise à jour gratuite plus longue ? « Le problème de ce délit, ce sont ses conditions drastiques, qui font que c’est compliqué d’aller chercher un industriel sur ce délit » – même s’il est possible qu’une action soit initiée, dans le futur, en ce sens. Pour rappel, ce délit sanctionne le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. C’est cette « intention hyper malveillante de réduire délibérément une durée de vie » qui est difficile à prouver.
À lire aussi : 10 ans plus tard, quel bilan pour le délit d’obsolescence programmée ?
Y compris dans le cas de Microsoft, dont les mises à jour sont toujours présentées comme des améliorations d’expérience, une façon d’avoir des équipements plus performants avec plus de fonctionnalités. En attendant, la date du 15 octobre s’approche, et à défaut de loi, les utilisateurs devront rapidement faire des choix.
01net.com a réalisé plusieurs tutos, que vous ayez choisi de prolonger les mises à jour de Windows 10, ou d’installer un autre système d’exploitation.
Comment installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible ?
Fin du support de Windows 10 : quelle distribution Linux choisir pour votre PC ?
Comment redonner vie à un vieux PC grâce à Linux ?
Comment installer Chrome OS Flex dès aujourd’hui pour redonner vie à un vieux PC ?
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.